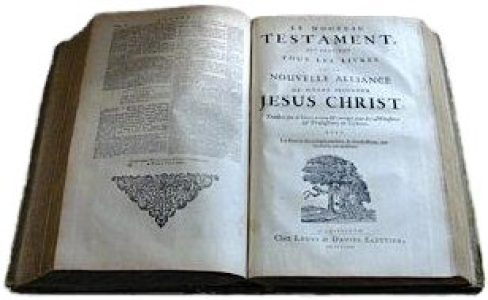Il est des textes que l’histoire n’a pas seulement conservés : elle les a chargés. Les Dictatus papae appartiennent à cette catégorie. Courts, abrupts, dépourvus de développements explicatifs, ils surgissent au XIᵉ siècle comme des sentences jetées dans la tourmente, et ils n’ont cessé depuis d’être brandis, tantôt comme étendard, tantôt comme pierre d’achoppement. Les critiques protestantes y ont souvent vu la preuve la plus éclatante d’une papauté devenue domination, d’un ministère spirituel mué en puissance terrestre. Pourtant, à la manière de l’historien qui s’efforce de suivre les chemins du passé sans les aplatir, il convient de s’arrêter, d’écouter, et de replacer ces paroles dans la trame vivante dont elles sont issues.
Les Dictatus papae ne sont pas nés dans le calme d’une bibliothèque, mais dans la chaleur d’un combat. Nous sommes autour de l’année 1075. L’Église d’Occident, depuis longtemps déjà, souffre d’une dépendance profonde à l’égard des puissances séculières. Les évêchés sont distribués comme des fiefs, les charges spirituelles deviennent monnaies d’échange, et le sanctuaire se trouve exposé aux intérêts du siècle. Face à cet état de choses se lève une génération de réformateurs, animés par la conviction que l’Église ne peut annoncer l’Évangile qu’à condition d’être libre. Au premier rang se tient le pape Grégoire VII, moine devenu pasteur universel, homme de prière autant que de gouvernement, persuadé que la réforme n’est pas une option mais une exigence de fidélité.
C’est dans ce contexte qu’apparaît ce texte singulier, inscrit dans le Registrum pontifical, sans solennité particulière, sans promulgation universelle : vingt-sept propositions, comme des notes de travail, ou mieux, comme un programme de résistance. Elles affirment la primauté du siège romain, l’impossibilité pour le pape d’être jugé par une autorité humaine, la supériorité de l’ordre spirituel sur l’ordre temporel. Lues sans précaution, elles frappent par leur dureté ; mais lues dans leur heure, elles révèlent la volonté farouche de soustraire l’Église à l’emprise des princes.
Car il faut se souvenir que, face au pape, se dresse l’empereur Henri IV, héritier d’une tradition impériale où le pouvoir se veut sacré, reçu de Dieu et s’exerçant sur l’ensemble du corps social, y compris ecclésiastique. La querelle des Investitures n’est pas une dispute de mots : elle engage la question décisive de savoir si l’Église est une réalité spirituelle autonome ou un département du pouvoir politique. Les Dictatus papae prennent alors la forme d’un rempart dressé contre l’ingérence, d’un langage volontairement tranché pour répondre à une violence institutionnelle réelle.
Il serait pourtant erroné de voir dans ces propositions une définition dogmatique de la papauté. Elles ne prétendent pas fixer pour tous les siècles la forme de l’autorité pontificale. Elles ne sont ni un concile, ni une bulle solennelle, ni un enseignement engageant l’infaillibilité. Elles relèvent d’un registre pratique et polémique, marqué par l’urgence. L’Église elle-même, dans la suite de son histoire, n’a jamais lu ces lignes comme une règle intangible, mais comme le témoignage d’un moment de tension extrême, où le langage s’est fait plus abrupt que nuancé.
C’est ici que se manifeste une difficulté récurrente dans certaines lectures réformées : la tentation de l’absolutisation textuelle. On isole un document, on le détache de la continuité vivante de l’Église, et on lui confère une portée qu’il n’a jamais revendiquée. Or, si l’Écriture sainte elle-même ne se livre qu’au sein de la matrice qui l’a portée – l’histoire d’Israël, la vie de l’Église apostolique, la Tradition qui en a gardé la mémoire –, combien plus les textes ecclésiastiques, œuvres humaines et situées, exigent-ils une lecture patiente et contextualisée. Le sola Scriptura pose déjà, on le sait, des questions herméneutiques redoutables ; le sola texta, appliqué à des écrits pontificaux, conduit plus sûrement encore au contresens.
Lire correctement les Dictatus papae, c’est donc accepter plusieurs règles de discernement. C’est d’abord distinguer les niveaux d’autorité et de portée au sein des documents de l’Église. C’est ensuite inscrire chaque texte dans la durée, en le mettant en regard de ce qui le précède et de ce qui le suit, plutôt que de l’ériger en clé unique d’interprétation. C’est enfin reconnaître que l’Église, pèlerine dans l’histoire, a parfois parlé le langage rude de son temps, sans pour autant se confondre avec ce langage.
Ainsi compris, les Dictatus papae cessent d’être une arme polémique pour redevenir ce qu’ils sont réellement : le reflet d’une Église aux prises avec le siècle, cherchant, parfois avec des mots excessifs, à sauvegarder la liberté de l’Évangile. Ils ne disent pas tout de la papauté, pas plus qu’un cri de bataille ne résume une nation. Ils invitent plutôt à une lecture humble et historique, attentive à la continuité comme aux ruptures, et soucieuse de discerner, sous les formes changeantes, la permanence d’un ministère ordonné à l’unité et au service.