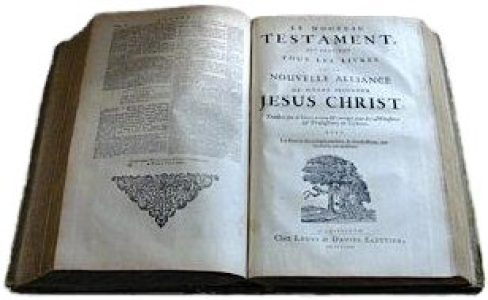Peut-on exiger de l’origine ce que seule la maturité permet de formuler ?
Il est une objection souvent répétée par certains réformés, avec une assurance tranquille : si le modèle mono-épiscopal est véritablement voulu par Dieu, disent-ils, alors la distinction entre presbytres et évêques devrait être donnée dès l’origine, clairement établie, reconnue comme de droit divin explicite. À défaut, l’épiscopat personnel ne serait qu’une construction progressive, respectable peut-être, mais privée de toute nécessité normative. La succession apostolique, dans cette perspective, perdrait son fondement.
Cette objection, si elle paraît rigoureuse, repose pourtant sur une attente profondément étrangère à la manière dont Dieu agit dans l’histoire. Elle suppose que l’Église aurait dû naître toute armée, déjà pourvue de catégories stabilisées, de définitions achevées, de frontières nettes entre les ministères. Or l’Église n’est pas née comme un système ; elle est née comme un corps vivant.
Le temps long de l’Incarnation
L’Incarnation elle-même nous avertit contre ce type d’exigence. Le Christ n’a pas livré une constitution ecclésiastique complète ; il a appelé des hommes, les a formés, envoyés, et leur a promis l’Esprit. Il a semé, non pas un code, mais une vie. Dès lors, demander que la distinction presbytre/évêque soit posée dès l’origine comme une norme juridique intangible, c’est méconnaître la pédagogie divine, qui fait croître ce qu’elle a d’abord fait naître.
Les Écritures elles-mêmes témoignent de cette phase encore fluide : les termes se chevauchent, les fonctions se recoupent, les structures se cherchent. Mais faut-il voir dans cette souplesse une absence de principe, ou au contraire la présence d’un principe encore en voie de clarification ? L’histoire de l’Église invite à la seconde lecture.
Une mission avant d’être une typologie
Ce qui apparaît avec constance, dès les temps apostoliques, ce n’est pas d’abord une distinction formelle d’offices, mais la conscience qu’une mission reçue doit être transmise. Les apôtres ne se perçoivent pas comme de simples témoins appelés à disparaître sans relais ; ils établissent, confient, délèguent. Ils imposent les mains, non comme un geste symbolique interchangeable, mais comme l’acte par lequel une charge est communiquée.
La succession apostolique ne suppose donc pas, à l’origine, une théorie achevée de l’épiscopat ; elle suppose une conviction plus fondamentale encore : l’Église ne se refonde pas à chaque génération, elle se reçoit. Et cette réception passe par des hommes identifiables, reconnus, envoyés à leur tour.
Dans ce contexte, la distinction ultérieure entre presbytres et évêques n’apparaît pas comme une invention arbitraire, mais comme une clarification progressive d’une réalité déjà vécue. Le mono-épiscopat n’est pas une rupture avec l’âge apostolique ; il est la forme stable qu’a prise, sous l’action de l’Esprit, la responsabilité apostolique transmise.
L’unanimité silencieuse de l’Église ancienne
Il est frappant de constater que lorsque, au début du IIᵉ siècle, l’Église parle explicitement de l’évêque comme d’un point de référence personnel et unique dans chaque Église locale, elle ne le fait ni avec gêne ni avec prudence excessive. Elle ne se justifie pas, comme si elle innovait. Elle parle comme on nomme ce qui est déjà reconnu.
Chez Ignace d’Antioche, l’évêque n’est pas opposé aux presbytres, mais entouré d’eux ; il n’est pas une figure solitaire, mais le garant visible de l’unité eucharistique et doctrinale. Nulle part Ignace ne laisse entendre que ce modèle serait une option parmi d’autres. Il parle depuis une Église qui se sait dans la continuité, non dans l’expérimentation.
Plus encore, lorsque surgissent des doctrines nouvelles, l’Église n’en appelle pas à une reconstruction abstraite du ministère, mais à la continuité concrète des hommes établis. Irénée de Lyon ne fonde pas l’autorité de l’évêque sur une distinction presbytre/évêque théoriquement démontrée ; il la fonde sur la chaîne vivante des successeurs, connus, nommés, enracinés dans les Églises apostoliques.
Le malentendu sur le « droit divin »
L’argument réformé repose souvent sur une conception étroite du droit divin : serait de droit divin uniquement ce qui est explicitement prescrit, dès l’origine, sous une forme définitive. Mais cette conception ne correspond ni à l’économie biblique, ni à l’expérience historique de l’Église.
Ce qui est de droit divin, dans la perspective catholique, n’est pas toujours donné comme une formule figée ; il est parfois donné comme une semence confiée au temps. Le ministère apostolique, voulu par le Christ, porte en lui la nécessité d’une transmission. Que cette transmission ait trouvé sa forme normative dans l’épiscopat personnel n’est pas une trahison de l’origine, mais son accomplissement organique.
Une Église qui se reconnaît héritière
Ainsi, il n’est nullement nécessaire que la distinction presbytre/évêque ait été formellement établie dès les premiers jours, ni qu’elle ait été reconnue d’emblée comme une norme juridiquement définie de droit divin, pour que le mono-épiscopat et la succession apostolique soient légitimes.
Ce qui est nécessaire — et ce que l’histoire atteste avec une force tranquille — c’est l’existence d’une conscience ecclésiale continue : celle d’une Église qui se sait héritière d’une mission confiée par le Christ aux apôtres, mission qui ne peut être ni réinventée ni redistribuée à volonté, mais reçue et transmise.
Exiger de l’Église primitive qu’elle parle déjà le langage conceptuel des siècles ultérieurs, ce n’est pas la respecter ; c’est la juger à l’aune d’un rationalisme étranger à son mode de vie. L’Église n’a pas commencé par se définir ; elle a commencé par croire, célébrer, transmettre. Et c’est précisément dans cette fidélité patiente que s’enracine la succession apostolique — non comme un théorème démontré, mais comme une vérité vécue, reconnue et gardée.